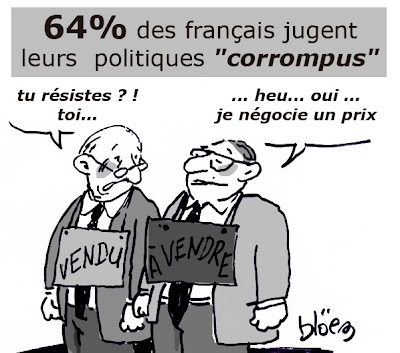par
Henry Coston
Le
texte suivant est paru en préface à « L’Argent et la
Politique » de Henry Coston, 1994, qui détaillait les comptes
de campagne des députés élus aux élections législatives de 1993,
pour lesquelles les contributions financières aux candidats avaient
dû être déclarées à la Commission des comptes de campagne et
avaient été publiées au Journal officiel du 12 avril 1994.
L’électeur
se figure que c’est lui qui élit son député. Il lui délègue,
effectivement, ses pouvoirs souverains, mais l’élu n’est pas,
pour autant, son véritable représentant. Souverain débonnaire et
confiant, l’électeur n’exerce pas vraiment sa souveraineté. Une
fois qu’il a déposé dans l’urne, tous les cinq ans, son
bulletin de vote, il a transformé son mandataire et l’a fait
entrer dans le Système qui fait des parlementaires et des
gouvernants, sauf très rares exceptions, les serviteurs, parfois les
laquais, des puissances d’argent.
Car
le Système n’est démocratique que de nom. En fait, il fonctionne
sous le contrôle étroit des oligarchies financières, qui règlent
la note de sa campagne électorale et qui subventionnent son parti.
Les
récents scandales dits « des fausses factures »
ont révélé que, pour remplir les caisses,
plusieurs partis usaient de ce procédé et profitaient de leurs
relations et de leur pouvoir pour monnayer leurs interventions au
niveau municipal ou départemental : la multiplication des
supermarchés qui éliminent les petits commerçants et favorisent la
désertification des campagnes n’a été possible, après
la loi Royer qui devait limiter leur nombre, que
grâce à la corruption des élus et des partis.
Toute
campagne électorale coûte cher. Il faut éditer un journal pour
défendre ses idées et, au besoin, couvrir l’adversaire d’injures.
Il faut offrir l’apéritif aux petits électeurs et un bon repas
aux électeurs influents. Il faut rétribuer les services des agents
électoraux et des « costauds » chargé de la bonne tenue des
réunions. Parfois même, pour décider les électeurs un peu
hésitants, faut-il leur remettre un petit « cadeau » pour leur
famille ou un petit « souvenir » pour eux-mêmes. Cela représente,
pour une circonscription moyenne, plusieurs centaines de milliers de
francs (la loi a fixé le total à un maximum de 500 000 F). À
condition que le candidat puisse trouver à emprunter cet argent dans
son entourage, il lui faudra des années pour le rembourser. Les
trois-quarts de son indemnité parlementaire y passeront. Si le
candidat n’est qu’un arriviste besogneux, il se jette dans la
bagarre tête baissée : il risque le tout pour le tout. Combien de
politiciens battus aux élections se sont couverts de dettes (en
particulier chez les imprimeurs d’affiches, de tracts, de
publications) et ont du mal à les « éponger » pour peu que,
n’ayant pas atteint les 5% des suffrages exprimés, ils ne soient
pas remboursés des dépenses de propagande officielle, ou que leur
parti ou leur comité électoral ne les aide pas à faire face à ces
débours.
Il
est rare — mais il y en a, heureusement, quelques-uns — qu’un
candidat soit indépendant des puissances d’argent dès le départ.
Cependant,
nombre de ces aspirants députés ont une situation qui leur rapporte
plus d’argent que ne représentera leur indemnité parlementaire.
Alors, pourquoi la quittent-ils ? Pour avoir l’honneur de défendre
les intérêts d’électeurs qu’ils ne connaissent pas ? Peut-être
est-ce en effet cela qui guide les idéalistes (il y en a sur tous
les bancs). Mais il faut vivre, et les frais d’un parlementaire,
obligé de tenir son rang, sont élevés. Avec les quelques dizaines
de milliers de francs qui lui resteront après le remboursement des
sommes prêtées pour sa campagne électorale, il aura tout juste de
quoi ne pas mourir de faim.
— Quel
désintéressement ! Direz-vous.
«
Pour moi, devant tant de sacrifices, je me sens pris de pitié »,
s’exclamait Francis Delaisi, qui ajoutait aussitôt : « Toutefois,
n’exagérons rien. Les héros sont rares, dans tous les temps. Et
l’on ne comprendrait pas qu’il y eût tant de postulants à la
députation si le mandat ne comportait quelques petits profits. »
(Francis Delaisi, in La Démocratie et les Financiers.)
Le
candidat ne supporte pas seul les frais de la campagne électorale.
La caisse de son comité l’aide. Ce comité est composé
principalement de partisans zélés qui paient de leur personne mais
sont impuissants à remplir la caisse. On va donc taper ceux qui sont
réputés « avoir les moyens ».
C’est
là que commence la compromission. Bien sûr, le petit industriel du
coin, qui y va de son petit chèque, par sympathie personnelle ou par
conviction politique, ne demande rien en échange. Mais les autres,
les gros, qui versent des dizaines de milliers de francs
officiellement et, sans doute, beaucoup plus, officieusement ? (C’est
interdit, maintenant, mais cela se pratique toujours : on se montre
plus prudent, voilà tout. . .) Il y a aussi les organisations
économiques ou patronales, liées aux grands trusts. Quelles que
soient les opinions
personnelles des grands dispensateurs de fonds de ces organismes —
jadis le Comité Mascuraud, l’Union des intérêts économiques, le
Comité des Houillères, remplacés de nos jours par le CNPF et les
autres syndicats patronaux — , l’argent est distribué aux
candidats de droite, de gauche et du centre. Ces messieurs jouent sur
tous les tableaux pour être sûrs de ne pas perdre. L’essentiel,
pour eux, c’est de rendre service au futur député qui, une fois
élu, sera mis en demeure de leur manifester sa reconnaissance. S’il
arrivait que le nouvel élu fût infidèle, c’est-à-dire trop
indépendant pour favoriser les intérêts permanents du grand
capitalisme, on lui ferait bien vite comprendre qu’il serait
proprement battu aux élections suivantes. Peu de parlementaires
résistent à de pareils arguments.
Le
plus souvent, le député qui a profité des largesses des banques et
des trusts — ou de leurs filiales locales ou régionales —
prendra goût à cette manne. S’il est ambitieux et avide, il
tâchera d’obtenir un poste d’administrateur dans l’une des
sociétés qui dépendent de son groupe. Aux députés avocats, les
trusts confieront l’étude d’un dossier.
Avant
le vote de la loi qui restreint certaines pratiques, beaucoup de
parlementaires entraient dans le jeu et allaient siéger dans les
conseils d’administration de grandes sociétés. J’ai donné
leurs noms et leurs fonctions dans Les Financiers qui mènent le
monde.
Il
arrive aussi que des députés ou des sénateurs, au lieu de devenir
administrateurs de sociétés, aient fait le trajet inverse, et que
hommes d’affaires, ils aient été détachés comme parlementaires
par le groupe financier qu’ils représentent. Le cas d’un
Loucheur ou d’un Louis-Dreyfus, sous la Troisième République,
d’un Corniglion-Molinier, d’un Dassault, ou encore d’un
Missoffe, sous la IVe et
la Ve, est resté célèbre.
Quand ils ne sont pas administrateurs de sociétés, on les trouve
conseils de grands groupes financiers comme Mendès-France, qui était
l’avocat du trust international Bunge.
Avec
le gouvernement Mendès-France, la pénétration du capitalisme était
moins visible, moins franche. Et cependant la presse d’opposition
ne s’y est pas trompée. Aspects de la France, qui ne passe
pas pour un journal de la démagogie anti-capitaliste, mettant en
cause les ministres les plus fortunés de Pierre Mendès-France,
écrivait au lendemain de la formation du gouvernement :
Que
les temps sont changés : Casimir Périer a dû se démettre de ses
fonctions de président de la République à la suite d’une
campagne de presse du socialiste Gérault-Richard qui l’accusait de
n’être quelqu’un ou quelque chose que grâce à sa seule
richesse.
Même
campagne contre Berteaux qui fut ministre de la Guerre, contre Pams
qui fut ministre de l’Intérieur et faillit être l’élu du
Congrès de Versailles à la fin du septennat Fallières, et contre
Louis Loucheur, que l’on appelait Tout-en-Or.
Que
n’aurait-on pas entendu entre 1890 et 1914 si un gouvernement avait
rassemblé ces possesseurs d’énormes fortunes que sont MM.
Mendès-France, Bettencourt, Guy La Chambre et Emmanuel Temple ?
Si
l’on additionnait celles-ci, on obtiendrait un nombre considérable
de milliards.
Et
c’est pour ce gouvernement de milliardaires que communistes et
socialistes ont voté comme un seul homme.
Quelqu’un
nous a dit : « C’est cela qu’on nous donne comme gouvernants
alors qu’il serait utile que nous ayons, en ce moment, des hommes
connaissant vraiment les difficultés des fins de mois de ceux qui
travaillent pour gagner leur vie et non pas pour arrondir leur
fortune. »
C’est
exactement notre point de vue.
Les
quatre ministres cités n’étaient pas les seuls « capitalistes »
du cabinet Mendès-France. Il y avait d’autres amis ou obligés des
trusts et de la finance . Dans Le Retour des 200 Familles,
paru au lendemain de la fondation de la IVe
République, j’ai soulevé un coin du voile qui recouvrait
l’opération politicofinancière qui permit au Général de
reprendre le pouvoir après une longue traversée du désert.
Cette
collusion du gaullisme et de la finance remontait aux années
sombres, à l’époque du Comité d’Alger, lorsque René Mayer,
neveu des Rothschild et futur directeur de leur puissante banque,
juste avant Pompidou, devint en quelque sorte ministre du Général.
Lorsque fut constitué le Gouvernement provisoire, plusieurs
fidei-commissaires des oligarchies financières en firent partie :
René Mayer, déjà nommé, et Emmanuel Monick, futur président de
Paribas et vice-président du trust vert (Hachette). Aimé Lepercq,
représentant les intérêts Schneider (Le Creusot), siégea auprès
du représentant des intérêts rothschildiens, René Mayer, dans le
deuxième Gouvernement provisoire constitué en septembre 1944, ainsi
que dans le premier cabinet De Gaulle (1944–1945), rejoint dans le
deuxième cabinet (1945–1946) par Louis Jacquimot, futur époux
d’une fille du banquier Lazard, qui revint au gouvernement lorsque
le Général constitua son ministère en 1958, flanqué de
Maurice-Bokanowski, qui avait de gros intérêts dans le textile.
De
nos jours, les hommes d’affaires se tiennent plutôt dans l’ombre
des gouvernants, voire dans l’intimité des présidents de la
République. Ancien directeur général de la banque de Rothschild
frères, Georges Pompidou rompit avec les intérêts
rothschildiens lorsqu’il eut la responsabilité du pouvoir. À Guy
de Rothschild qui lui demandait on ne sait quel service, il aurait
répondu, un jour, sur un ton peu aimable :
— Je
ne suis plus au service de votre banque !
Les
difficultés qu’il connut lorsqu’il fut à l’Elysée, avec
certaines puissances occultes, ne sont pas étrangères à son
attitude très réservée à l’égard des intérêts oligarchiques.
Ses
successeurs n’ont pas eu le même comportement. Passons sur Giscard
d’Estaing, dont les intérêts matrimoniaux se confondent avec ceux
de la famille Schneider (du Creusot) — son épouse, Anne-Aymone de
Brantes, est fille de Marguerite Schneider et l’associée et
cliente, dans certaines affaires, de la banque Lazard. Battu aux
élections présidentielles de 1981, il eut pour successeur François
Mitterrand, qui avait su faire oublier la francisque dont le décora
le maréchal Pétain pour devenir ministre de Mendès-France en 1955
et Premier secrétaire du Parti socialiste en 1971.
Ce
dénigreur épisodique du Grand Capital est probablement le président
le plus entouré de milliardaires que notre République ait connu. Ce
n’est pas pour rien que L’Expansion, la revue économique,
appelait Jean Riboud « Le P. D. G. du Président 6
». Ami intime de Mitterrand, millionnaire en dollars,
bénéficiant du plus haut salaire des « patrons » travaillant aux
États-Unis, Jean Riboud (décédé il y a de nombreuses années)
était de P. D. G. de Schlumberger, une multinationale dont la
richesse et la puissance dépassent celles d’un État moyen. Il
était le frère du P. D. G. de BSN-Danone, l’un des plus
importants « capitalistes » de la Ve
République. Autre « gourou » du président Mitterrand :
François Dalle, hier encore patron du numéro un international du
cosmétique, L’Oréal, lié au trust Nestlé, marques mondialement
connues. Le créateur de L’Oréal, Eugène Schueller, était, avant
la guerre, l’un des commanditaires de la Cagoule et, pendant la
guerre, l’un des dirigeants (co-fondateur) du MSR, le mouvement
nationaliste fascisant de son ami Eugène Deloncle. La fille de
Schueller, Mme André Bettencourt, est toujours « patron » de
L’Oréal ; elle est aussi, avec son mari, ancien ministre de
Mendès-France, une intime du président Mitterrand, dont Schueller
avait fait un directeur de sa revue Votre Beauté, en 1946.
Le
scandale Pelat, mort quelques jours avant d’être arrêté pour
divers délits financiers, a attiré l’attention sur les
fréquentations douteuses de l’hôte socialiste de l’Élysée.
L’amitié du président Mitterrand pour ce financier véreux,
devenu l’ami de Bérégovoy, a coûté la vie à l’ancien Premier
ministre, qui n’a pu supporter le déshonneur. Un autre homme
d’affaires, franc-maçon et trotskiste, Max Théret, qui fut
longtemps le patron de la FNAC et, également, un proche du Parti
socialiste et de l’Élysée, connut la honte de la condamnation (2
ans de prison avec sursis et 2 millions et demi de francs d’amende,
en première instance) pour délit d’initié (avec son complice
Pelat). Il faut dire qu’une partie des profits qu’il tirait de
ses combines alimentait les caisses de divers partis, associations et
journaux de gauche : le PSU, puis le Parti socialiste, dont il fut
membre, SOS-Racisme et surtout Le Matin de Paris, qui devait
être « le grand quotidien d’information » de la gauche
socialiste. Après avoir tenté de racheter France-Soir en 1982, au
lendemain de la victoire de Mitterrand à l’élection
présidentielle, il devint le commanditaire et le patron du Matin
: il y perdit une grande partie de sa fortune ; « Max Théret était
milliardaire avant l’arrivée de la gauche au pouvoir », a dit
Bertrand Delanoë, conseiller de Paris et secrétaire de la section
socialiste à laquelle Théret appartient. « Il ne l’est plus. Il
a plus servi ses convictions que ses convictions ne l’ont servi »
(Le Monde, 27 mai 1994). Peut-on en dire autant d’un autre «
manieur d’argent » du nom d’André Rousselet, autre intime de
Mitterrand, qui domina de longues années Canal+, la chaîne à péage
que le tandem Havas-Cie Générale des eaux vient de lui arracher ?
Rousselet aussi est un intime de l’Élysée : il en a même été
le secrétaire général. Avec un pareil entourage, on devine que le
président de la République est plus proche des intérêts du «
Gros Argent » que des angoisses
des défavorisés de la vie. Mais revenons aux parlementaires qui, du
moins officiellement, font les lois auxquelles les Français sont
tenus d’obéir. Parmi ces 577 membres de notre Assemblée nationale
qui, en fin de compte, imposent leurs volontés à un Sénat réduit
à un rôle secondaire par la constitution de 1958, combien de
députés sont
capables d’aborder les questions importantes (finances, économie,
fiscalité, exportation, douanes, etc.) ? S’il leur faut étudier
toutes celles qui leur sont soumises, quand pourraient-ils s’occuper
de leurs électeurs ?
Ils
constituent des commissions, dont les membres sont chargés d’étudier
les affaires. À leur tour, ces commissions désignent un rapporteur.
C’est ce dernier qui fait tout le travail. Lorsque son rapport est
prêt, la commission l’adopte, quelquefois après l’avoir amendé.
Puis ce gros dossier de deux cents à cinq cents pages bourrées de
chiffres, de statistiques et de graphiques est soumis à l’Assemblée
tout entière. En principe, chaque député devrait lire ce volumineux rapport. En fait, rares sont ceux qui le parcourent. Aussi
l’adoptent-ils sans grand changement. Qui connaîtrait mieux la
question que le rapporteur ? se disent-ils, et ils font confiance à
leur collègue.
— Un
bon rapporteur vaut une mine d’or, disait
un financier, qui savait tirer parti de la collaboration d’un
député arriviste et pas trop scrupuleux. Hélas ! il y en a un
certain nombre sur les travées du Palais Bourbon, dans tous les
groupes : ils ne sont pas la majorité, loin de là, mais il suffit
que les oligarchies financières en aient quelques-uns, bien placés,
dans leur manche, pour que leurs intérêts soient sérieusement
défendus, au détriment (si besoin est) de l’intérêt général.
Il
va sans dire que le parlementaire qui peut faire gagner cent millions
(parfois des milliards !) à tel importateur ou consortium
immobilier, à tel gros entrepreneur de travaux publics, est
particulièrement soigné par ces « capitalistes ». De même
qu’elles ont recours, pour le recrutement de leur personnel
supérieur, aux fameux « chasseurs de têtes », ces grandes
sociétés cosmopolites disposent d’un ou de plusieurs conseillers
politiques pour la recherche des cracks en herbe susceptibles de les
servir. On n’attend pas que les personnages convoités soient
devenu des leaders politiques pour se les attacher : on les recrute,
en quelque sorte, avant qu’ils soient en place.
Le
scandale des fausses factures a révélé que c’est au premier
stade, celui de l’élu local ou régional, que le corrupteur agit.
Les aides financières accordées aux candidats à la députation le
sont rarement à des inconnus. Sans doute, les candidats ne seront
pas tous élus, et, parmi les élus un très grand nombre d’entre
eux ne céderont jamais à ces « amicales pressions ». Le député
ayant des convictions et des scrupules, neuf fois sur dix, restera
dans son coin, évitera de se faire remarquer et... se fera battre
aux élections suivantes. Mais s’il est, au contraire, ambitieux,
effronté et avide, il se servira de ceux qui l’ont aidé
financièrement pour réussir et, en retour, il se mettra à leur
disposition. Cet échange de bons procédés favorisera la carrière
du parlementaire qui deviendra l’une des vedettes du Palais Bourbon
et, qui sait ? secrétaire d’État ou ministre. Les « grosses
têtes » de l’Assemblée Nationale refusent parfois d’entrer
dans le jeu, mais le plus souvent elles acceptent d’entrer dans le
Système qui régit toute la politique française. Bien peu échappent
au carcan doré...
C’est
donc, dès ses premiers pas, que le futur député est pris en main
par les oligarchies
financières. Parfois cela n’est qu’une tentation, le futur
parlementaire ne
se laissera pas faire : il accepte les subventions qu’on lui donne,
mais refuse
ensuite de répondre favorablement aux avances de ses bailleurs de
fonds électoraux.
Ces derniers se doutent bien qu’ils ne seront pas gagnants à tous les
coups. Aussi leurs versements, pendant les campagnes électorales,
sont-ils effectués
à plusieurs candidats concurrents.